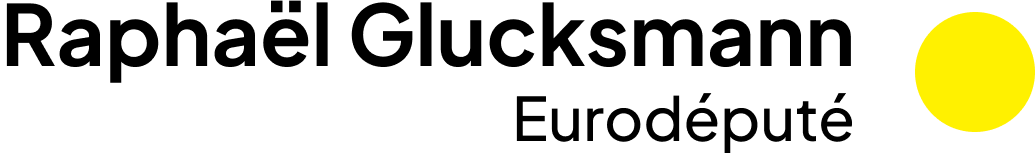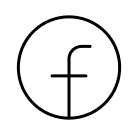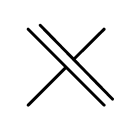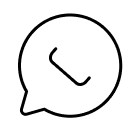Un gouffre que rien ne viendra jamais recouvrir
Il y a 30 ans aujourd’hui. Il y a 30 ans, le génocide des Tutsi du Rwanda commençait.
Pendant trois mois, 10 000 personnes furent exterminées chaque jour pour le seul crime d’être nées. Un million d’êtres humains furent exterminés en 100 jours.
Des marais du Bugesera aux collines du Bisesero en passant par les ruelles de Kigali, un pays entier était transformé en charnier. Une fracture universelle s’ouvrait dans l’Histoire humaine.
Un gouffre béant que rien ne viendra jamais recouvrir.
J’avais quinze ans et je me souviens comme si c’était hier des premières images télévisées des massacres. On voyait un groupe de miliciens macheter des civils dans une rue de la capitale rwandaise. En quelques secondes, j’avais basculé hors de l’enfance.
Dans les jours, les semaines, les mois qui suivirent, je ressentis un irrépressible besoin de comprendre ces images. De comprendre ce qui se passait au Rwanda et de comprendre les enchâssements de cette histoire tragique avec la nôtre, celle de notre Etat, de notre nation. Alors j’ai lu, frénétiquement. Puis, avec deux amis de lycée, David Hazan et Pierre Mezerette, nous avons commencé une enquête sur le génocide et sur le rôle de la France.
Nous sommes partis au Rwanda quelques années plus tard. A 20 ans, nous avons écumé les fosses communes. Nous avons interrogé, filmé, enquêté pendant des années. Nous avons approché l’abîme sans jamais pouvoir le saisir. À un certain point d’intensité, la douleur est intransmissible et la réalité ne peut qu’être esquissée. Alors chaque année, lorsqu’avril revient, cet abîme se dévoile et se dérobe en se dévoilant. Car le cœur du génocide sera toujours inaccessible à ceux qui n’en n’ont pas été les victimes.
Ce que nous pouvons, ce que nous devons faire, c’est approcher l’évènement au plus près selon notre perspective propre, notre perspective d’êtres humains et de citoyens français. Quand on se heurte aux corps suppliciés et aux âmes détruites, quand on déterre des cadavres à 7h du matin dans une fosse septique de Kigali avec une amie en quête des restes de sa mère, quand on prend dans ses bras les orphelins qui découvrent la chemise d’un père disparu, on donne un sens différent aux mots d’humanité, de justice ou de vérité, on leste ses discours d’un poids autre.
Au Rwanda, chaque individu qui se penche sérieusement sur ce que signifie l’humain est pris de vertige. Mais le citoyen français plus encore que les autres. Car ce n’est pas seulement notre commune humanité qui nous relie à ces corps mutilés et à ces âmes brisées, c’est aussi notre histoire politique, l’histoire d’une collaboration de notre Etat avec les massacreurs avant, pendant et après le génocide.
C’est l’histoire du plus grand scandale de la Cinquième République, d’un scandale qui n’a jamais vraiment totalement éclaté, l’histoire donc, aussi, du voile de déni méthodiquement posé sur cette infamie pendant plus de deux décennies.
Il aura fallu attendre vingt-sept longues années pour que la réalité commence à être officiellement dévoilée, reconnue, admise. Presque trois décennies pour que le rapport rédigé par l’historien Vincent Duclert établisse « la responsabilité lourde et accablante » des dirigeants français d’alors qui ont soutenu, financé, armé et plusieurs fois sauvé militairement le régime qui a lancé le génocide.
Cette vérité amère, qui accable un Président de gauche d’abord et un gouvernement de droite ensuite, cette vérité que je cherche depuis mes quinze ans et que je placerai toujours au-dessus, très au-dessus des familles idéologiques et des camps politiques se profile enfin à l’horizon. Nous la devons aux victimes. Aux rescapés. A nous-mêmes, Français, aussi.
La vérité donc, la justice aussi. Après le génocide, certains responsables Hutu se sont réfugiés en France où ils ont pu fuir leurs responsabilités des décennies durant. Depuis quelques années des dossiers se ré-ouvrent, des procès se tiennent. De temps à autre, le soulagement de la justice partiellement rendue vient calmer la crainte que les bourreaux n’échappent définitivement à leur condamnation. Mais la lutte pour la justice continue et je la mènerai, à la place qui est la mienne, jusqu’au bout. Pour Thierry, Annick, Jeanne et tous les autres.
Dans Une initiation, le livre qu’il lui a consacré, l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau, venu d’un espace conservateur, écrit que la rencontre avec le génocide des Tutsi l’a obligé « à penser – éventuellement à agir – contre son propre camp. »
Ce fut aussi mon cas. Enquêter sur le génocide des Tutsi, c’était nécessairement critiquer la politique menée par la France et critiquer en particulier la politique menée par la gauche française au pouvoir dans les années 1990. Je comprends que cela soit douloureux. C’est pourtant vital. Plus encore lorsqu’on aime passionnément l’histoire de la France et de la gauche française.
Il n’y aura donc pas de fin à cette quête de vérité et de justice entamée il y a 30 ans. Au nom des disparus. Au nom des survivants. Au nom aussi de la haute idée que je me fais de la France.